Une avancée majeure vers une société plus inclusive
Depuis le 28 juin 2025, la directive européenne permet à l’accessibilité numérique de devenir un enjeu central pour garantir à chacun un accès équitable aux services et produits en ligne. En Europe, plus de 87 millions de personnes vivent avec un handicap — soit environ un adulte sur cinq. En France, l’INSEE estime à près de 12 millions le nombre de personnes concernées. Mais au-delà du handicap au sens strict, les problématiques d’accessibilité touchent également les personnes âgées, les personnes temporairement blessées, ou celles confrontées à des situations de limitation fonctionnelle ponctuelle (équipements inadaptés, environnement bruyant, etc.).
L’accessibilité ne se limite donc pas à un enjeu social : c’est une condition d’égalité d’accès aux droits, un levier d’innovation, et une opportunité pour construire une société numérique plus inclusive.

Webinar :
Cas client, comment travailler la clarté des contenus et l’accessibilité numérique.
Une construction progressive du cadre légal
Au niveau international, l’Union européenne est partie prenante depuis 2011 de la CDPH (Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées). Cette convention impose aux États signataires de garantir l’accessibilité des produits, services, infrastructures et technologies.
En France, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits a jeté les bases de l’accessibilité numérique dans la sphère publique. Elle a été renforcée par la mise en œuvre du RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité), qui impose à certains sites publics et prestataires d’intérêt général de respecter des critères techniques précis, souvent alignés avec les standards internationaux comme les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
Mais à l’échelle de l’Union, l’absence de règles harmonisées engendrait des obstacles pour les entreprises opérant dans plusieurs États membres. La Directive (UE) 2019/882, dite European Accessibility Act (EAA), adoptée en avril 2019, vient répondre à ce besoin de convergence.
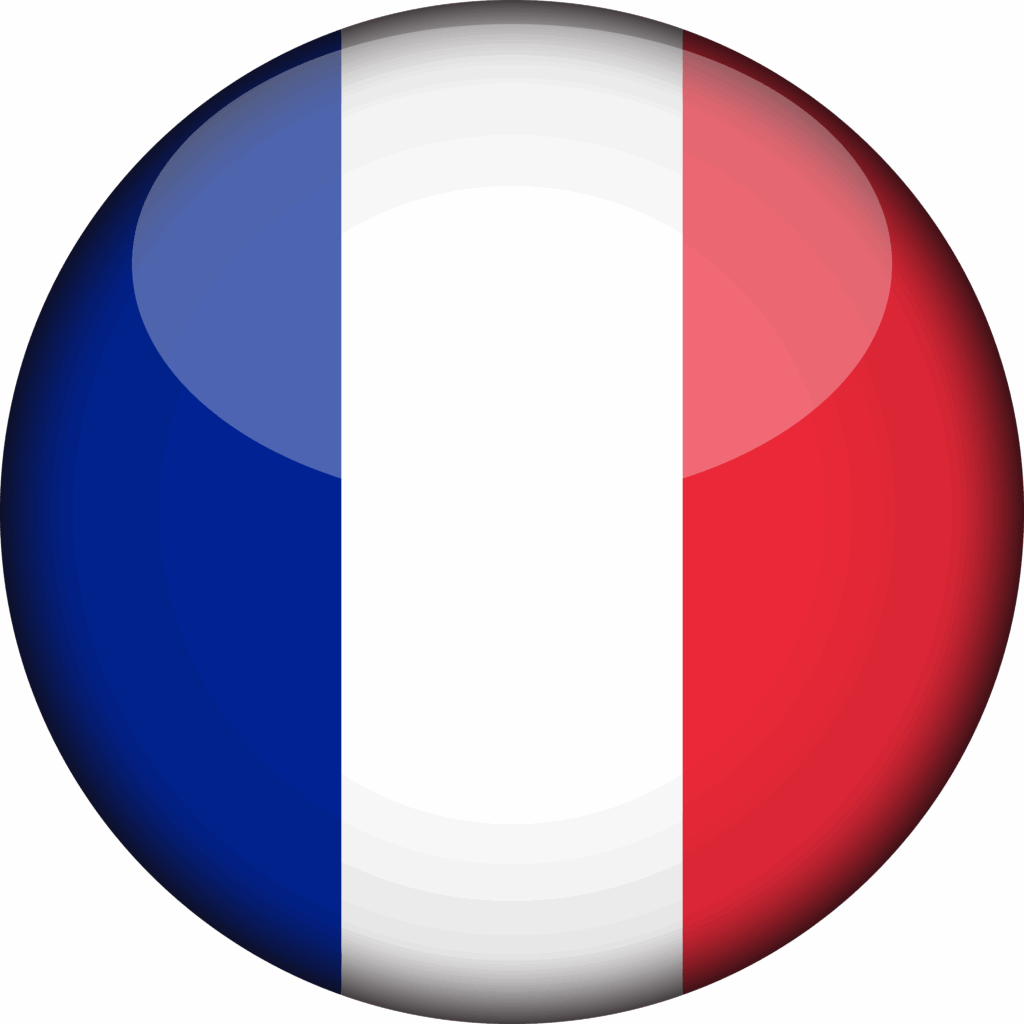
2005
- Organismes publics
- Collectivités territoriales
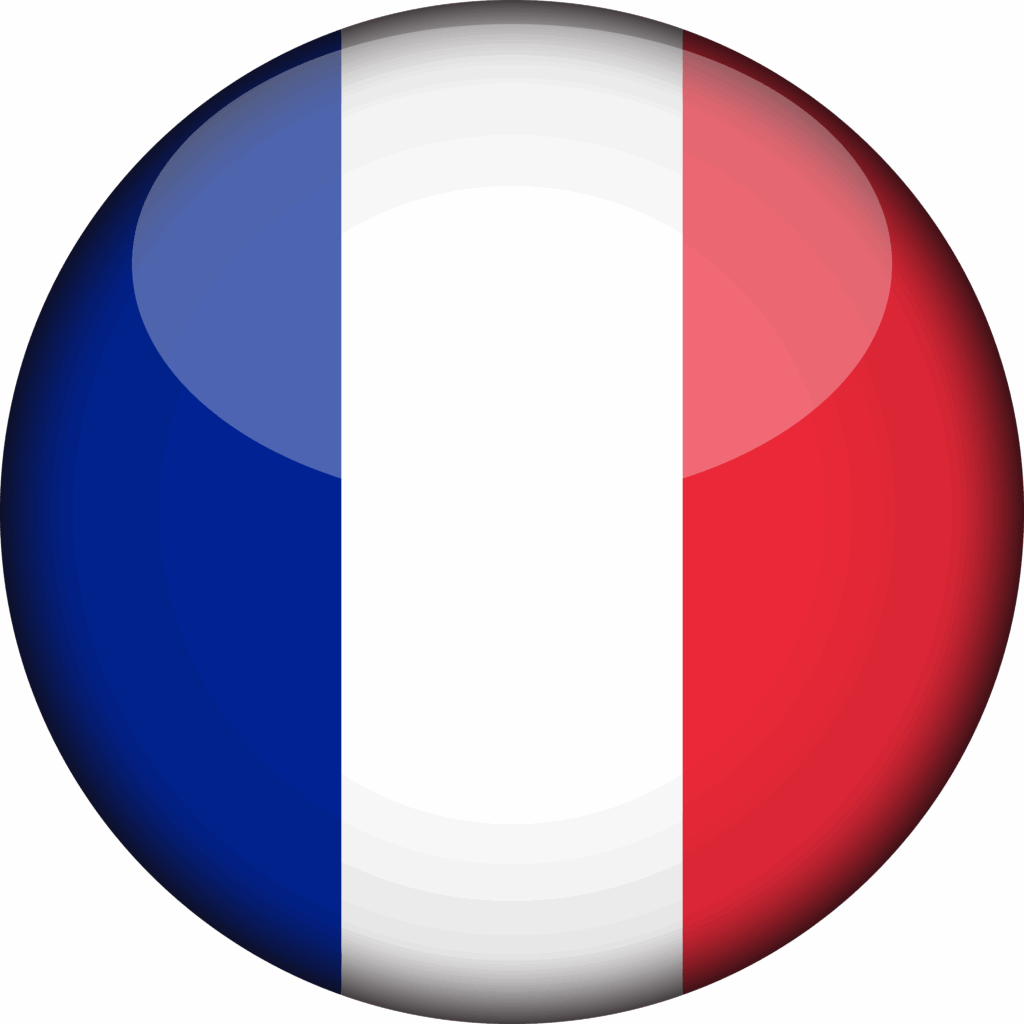
2016
- Organismes délégataires d’un service public
- Entreprises privées de + de 250 M€ CAs

2019
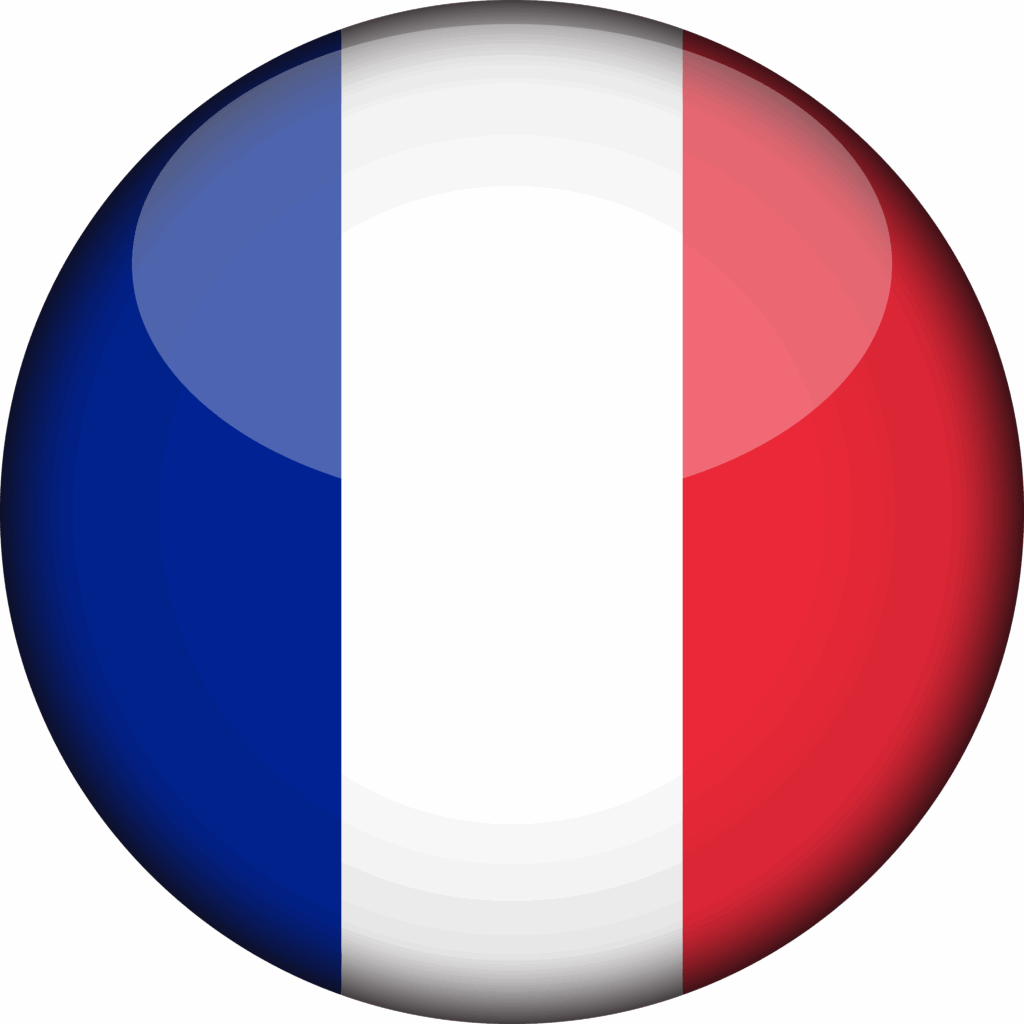
2023
- + de 2 M€ CA
- + de 9 personnes
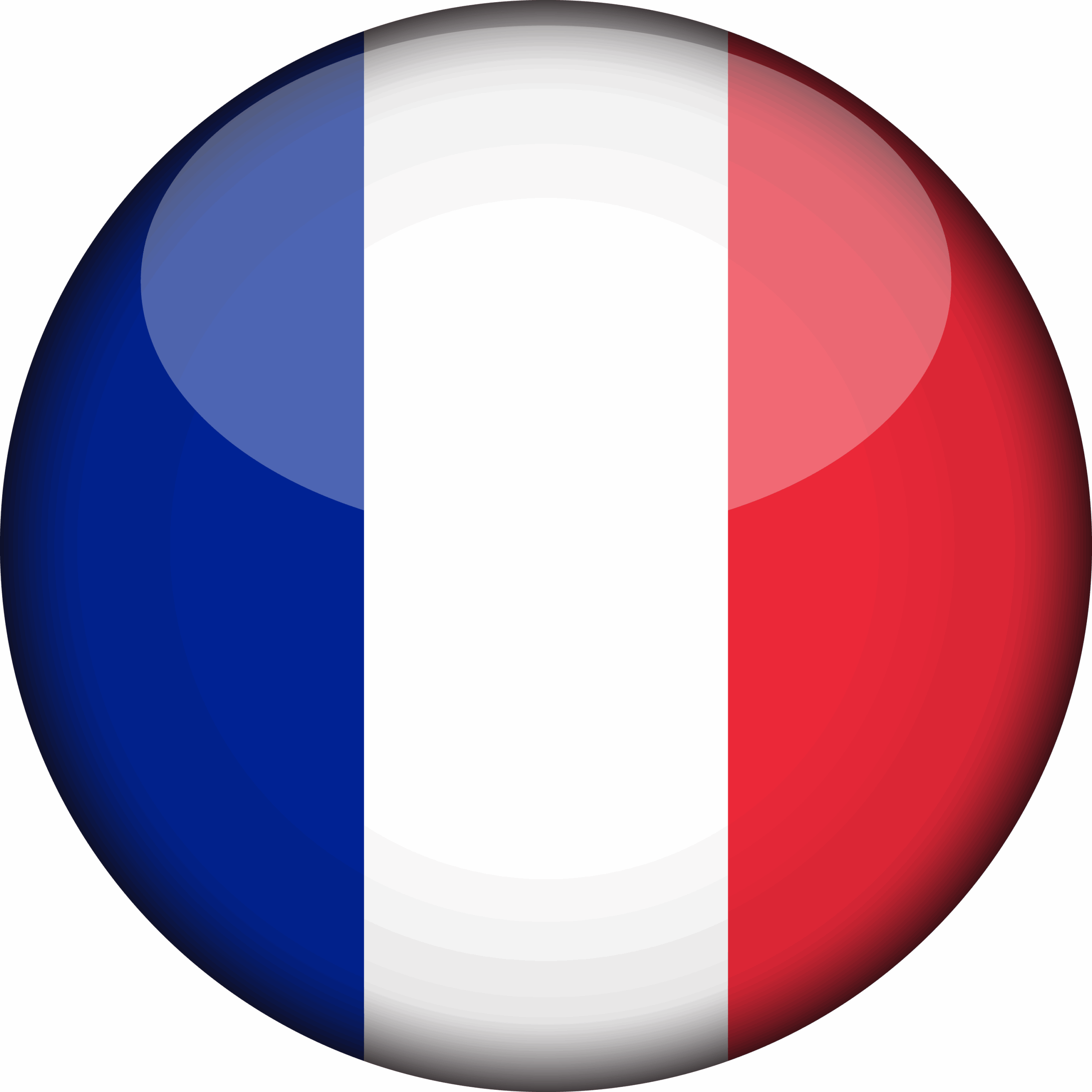
Entrée en vigueur au 28 juin 2025
Une directive ambitieuse et structurée
L’objectif de l’EAA est double :
- garantir l’accès aux produits et services essentiels pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles,
- harmoniser les exigences d’accessibilité dans le marché intérieur européen.
Les secteurs stratégiques
La directive couvre des secteurs stratégiques, dans lesquels l’accessibilité est jugée indispensable :
| Secteur | Exemples d’application |
|---|---|
| Services bancaires | • Sites web bancaires • Distributeurs automatiques (DAB) • Terminaux de paiement |
| Transports de voyageurs | • Billetterie électronique • Informations trafic en temps réel • Applications mobiles |
| Commerce électronique | • Sites web BtoC • Applications mobiles • Paiements en ligne |
| Communications électroniques | • Fournisseurs d’accès • Services d’appel • Équipements de communication |
| Médias audiovisuels | • Plateformes de streaming • Guides de programmes accessibles |
La directive a été transposée en droit français via laloi n° 2023-171 du 9 mars 2023, complétée par le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023. Les obligations de conformité entreront en application à partir du 28 juin 2025.
Qui est concerné par la directive ?
Tous les opérateurs économiques des secteurs mentionnés sont concernés : fabricants, importateurs, distributeurs, prestataires de services.
Exemptions
- Taille d’entreprise
Cependant, une exemption est prévue pour les microentreprises fournissant des services (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires ou bilan ≤ 2 millions d’euros), conformément à l’article 4(5) de la directive. - Justification économique
La directive Européenne introduit également un mécanisme dit de charge disproportionnée et de modification fondamentale, permettant à toute entreprise de justifier partiellement une non-application d’une exigence, lorsque celle-ci représenterait un fardeau excessif ou altérant profondément la nature du produit ou service. Cette possibilité est encadrée et ne doit pas être invoquée à la légère (l’absence de temps ou de connaissance ne constitue pas une justification légitime).
Quels sont les produits et services concernés ?
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-931 et à l’annexe I de la Directive (UE) 2019/882, les produits et services suivants doivent respecter les exigences d’accessibilité à partir du 28 juin 2025 :
À respecter les exigences d’accessibilité à partir du 28 juin 2025 :
- ordinateurs et systèmes d’exploitation
- terminaux de paiement et certains terminaux en libre-service tels que les distributeurs automatiques de billets de banque (DAB), les distributeurs de titres de transport et les distributeurs de tickets de file d’attente, les terminaux en libre-service interactifs ;
- les smartphones et autres équipements permettant d’accéder aux services de télécommunication ;
- les équipements de télévision incluant les services de télévision numérique ;
- les liseuses.
- les services de téléphonie ;
- les services qui fournissent un accès aux médias audiovisuels ;
- certains éléments des services de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime tels que les sites internet, les services mobiles, les titres de transport électroniques, les informations ;
- les services bancaires aux consommateurs ;
- les livres numériques ;
- le commerce électronique ;
- les communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112».
Quelles sont les exigences concrètes ?
Pour les services – sites internet et applications mobiles :
- Perceptible : veiller à ce que le contenu soit accessible visuellement et auditivement, en proposant par exemple des alternatives textuelles aux éléments non textuels, et en s’assurant que l’information reste intacte même avec des présentations différentes (comme une version avec mise en page simplifiée).
- Utilisable : permettre à l’utilisateur de s’orienter facilement dans la page, d’accéder à toutes les fonctionnalités au clavier, de disposer du temps nécessaire pour consulter les contenus, et éviter tout élément pouvant déclencher des troubles comme l’épilepsie.
- Compréhensible : garantir un fonctionnement cohérent des pages, et assister les utilisateurs dans la détection et la correction de leurs erreurs (ex : erreurs de saisie).
- Robuste : s’assurer que les contenus soient compatibles avec les technologies actuelles et à venir, y compris les outils d’assistance.
La conformité peut être démontrée en suivant des normes harmonisées, notamment la norme européenne EN 301 549 et les standards RGAA
Pour les produits :
- intégrer des dispositifs, fonctionnalités et caractéristiques facilitant leur perception, leur compréhension, leur utilisation, leur commande par les personnes en situation de handicap ;
- être soumis à un contrôle de conformité formel, incluant notamment le marquage CE ;
- disposer d’un emballage accessible, sauf dans le cas spécifique des terminaux en libre-service ;
- être accompagnés de notices ou d’explications compréhensibles et accessibles concernant leur utilisation ;
- offrir aux utilisateurs des services d’assistance adaptés, tels que des services clients, des supports techniques ou des centres d’appel capables de communiquer des informations sur l’accessibilité et la compatibilité du produit avec les aides techniques, par des moyens de communication eux aussi accessibles.
Qui sont les organismes de contrôle
Chaque État membre définit ses propres mécanismes de contrôle, d’évaluation et de sanction. En France, plusieurs autorités sont désignées pour assurer le respect des exigences de l’European Accessibility Act, comme le prévoit le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023 :
- Secteur E-Commerce : la DGCCRF
- Télécoms : l’ARCOM et l’ARCEP
- Médias audiovisuels : l’ARCOM et la DGCCRF
- Transports : la DGCCRF
- Banque, assurance, finance : l’ ACPR, l’ AMF et la Banque de France
Et quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?
Ne pas respecter ces réglementations peut entraîner plusieurs types de sanctions.
Sanctions civiles :
En vertu de l’article 131-13 du Code pénal et à l’article 132-15 du Code pénal, une personne morale peut se voir infliger une amende de 5e classe :
- initiale : 7 500 euros
- récidive : 15 000 euros
Sanctions pénales (pour discrimination) :
- 15 000 € (pers. physique)
- 75 000 € (pers. morale)
Au-delà de l’amende, les entreprises s’exposent à :
- des actions en justice engagées par des associations de défense des droits des personnes handicapées, fondées sur l’article L.111-7-11 du Code de la consommation ;
- un préjudice d’image en cas de signalement public ou médiatisé de leur non-conformité ;
- des impacts sur leur démarche RSE, l’accessibilité étant désormais un critère clé de responsabilité sociétale.
Une obligation, mais aussi une opportunité
Loin d’être une simple contrainte réglementaire, la mise en accessibilité constitue de nombreux avantages :
- économique : plus de visiteurs, plus de clients potentiels
- notoriété : un levier pour élargir sa base utilisateur (personnes handicapées, seniors, usagers mobiles, etc.)
- UX/UI : un moyen d’améliorer l’ergonomie globale
- RSE : un facteur de valorisation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Comment réussir sa mise en conformité ?
Plusieurs étapes sont recommandées pour accompagner la transition :
|
Service |
Description |
|
Audit |
Identification des écarts & priorisation – mémoires » (fr.linkedin.com) |
|
Conseil & stratégie |
Élaboration de la feuille de route – voir le service Ipedis Accompagnement MOE |
|
Formation |
Sensibilisation et montée en compétences via formations Ipedis |
|
Mise en accessibilité web |
Optimisation technique, conformité RGAA/WCAG |
|
Suivi & maintenance |
Tests périodiques, évolutions, ajustements continus |
La mise en accessibilité concerne également les documents PDF, qui restent un support largement utilisé dans les échanges avec les usagers, les clients ou les collaborateurs. Pour accompagner cette démarche, Ipedis propose deux solutions complémentaires : PDF Accessible plateforme, une plateforme qui permet de traiter efficacement des volumes de documents, et PubliSpeak, une solution innovante qui transforme les PDF en contenus web accessibles, interactifs et conformes aux normes en vigueur.
Des prestataires spécialisés comme Ipedis peuvent ainsi accompagner les entreprises dans chacune de ces étapes, en adaptant les actions aux spécificités de chaque structure.
L’échéance approche : soyez prêts
Selon l’article 12 de la Directive (UE) 2019/882, tous les produits et services concernés mis sur le marché ou fournis dans l’Union européenne devront être conformes à partir du 28 juin 2025, sauf cas d’exemption dûment justifiée. En France, cette obligation est confirmée par le décret n° 2023-931.
« Se préparer en amont permet non seulement de respecter la réglementation, mais aussi de se doter d’un avantage concurrentiel durable, en proposant une expérience plus inclusive. »
Vers une accessibilité universelle et évolutive
Avec l’essor de l’intelligence artificielle, des interfaces vocales, de la réalité augmentée, les enjeux d’accessibilité continueront d’évoluer. Intégrer dès aujourd’hui les principes du design universel permet non seulement de respecter la loi, mais aussi de concevoir des services plus intelligents, plus inclusifs et plus résilients face aux changements futurs.
Pour aller plus loin : un webinaire spécial pour vous aider
Pour aider les professionnels à mieux comprendre les enjeux de l’European Accessibility Act, nous avons récemment coorganisé un webinaire avec Razorfish France et Maître David Joseph Atias, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du numérique et en accessibilité.
Cette rencontre avait pour objectif de décrypter de manière claire et concrète le nouveau cadre juridique européen : ses obligations, les produits et services concernés, ainsi que les principales échéances à connaître. Un éclairage précieux pour toutes les organisations qui souhaitent anticiper leur mise en conformité et renforcer leur engagement en faveur de l’inclusion.
